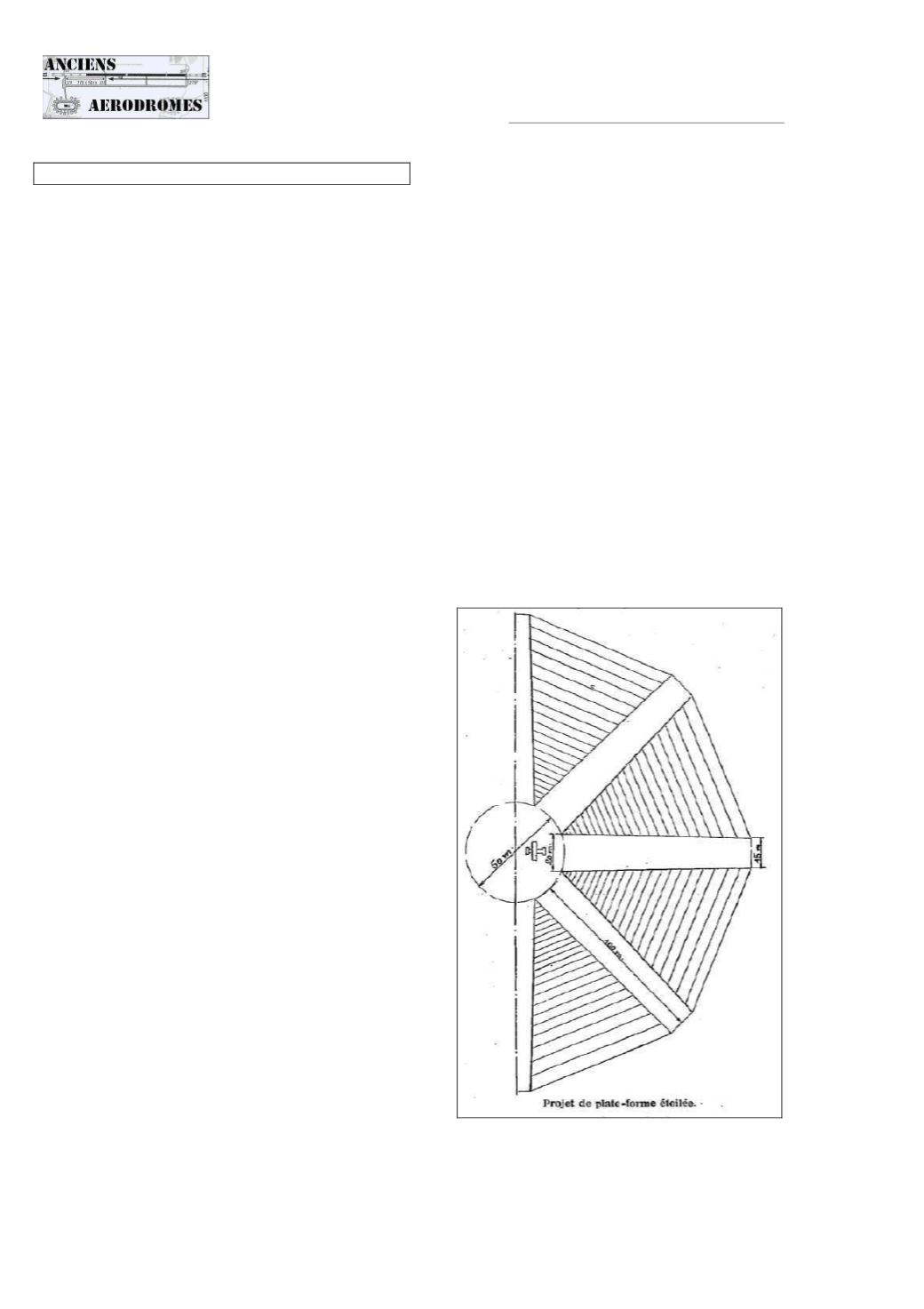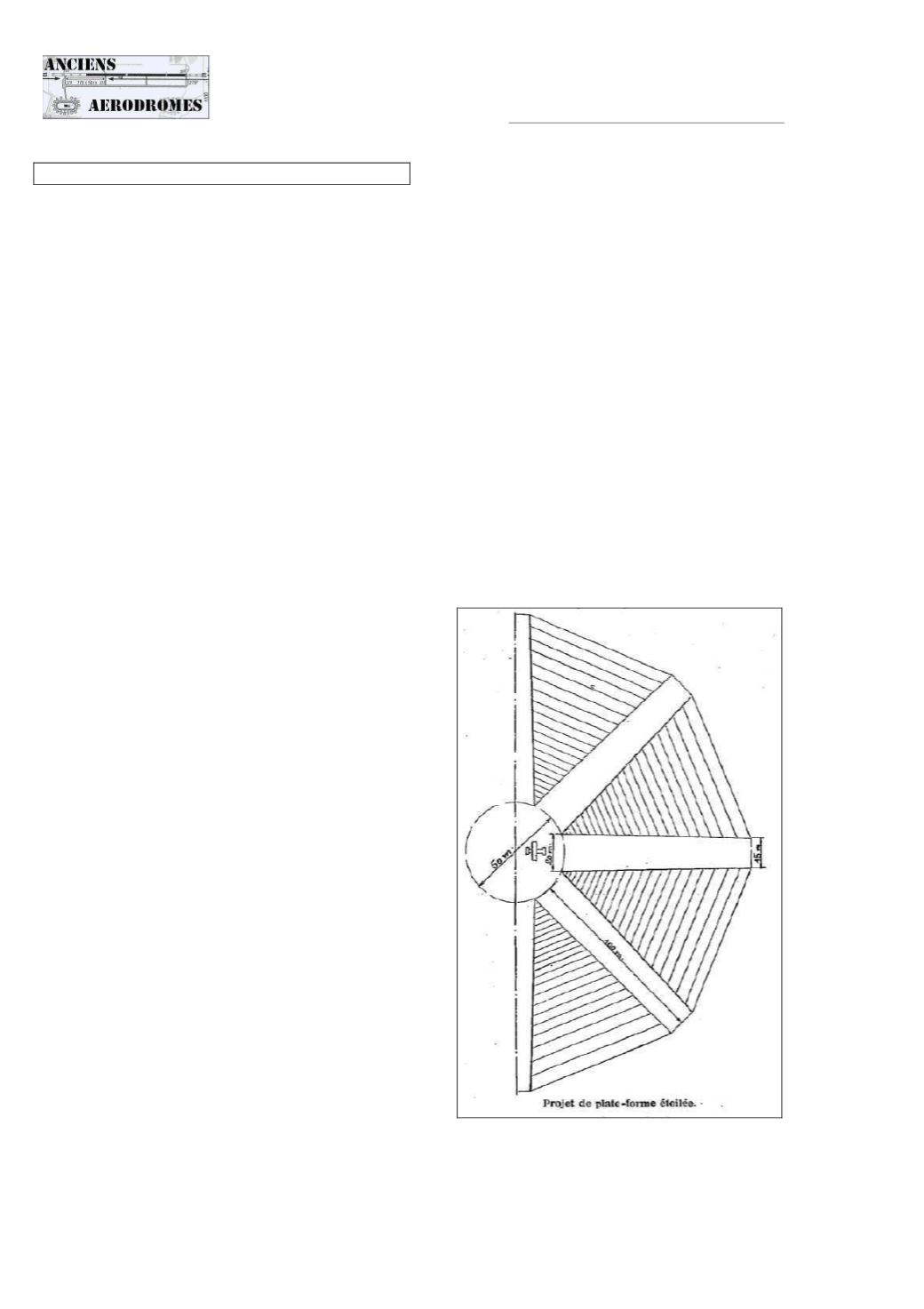
AB
C DE FE C BB
C
DE FE C FC CE C
C
C FC B
C C !"#$!
E C
5
L’aérodrome du mois
Une plate-forme étoilée pour l’essor des
Aéroplanes
« M. Armengaud Jeune, qui a assisté à un très
grand nombre d’expériences d’aéroplanes, a
constaté que le mode de lancement adopté par les
aviateurs français, soit avec les monoplans, soit
avec les biplans, était des plus défectueux. Neuf
fois sur dix l’essor ne se produit pas au moment
voulu, dès que la vitesse de régime est atteinte,
c’est-à-dire lorsque la réaction verticale due à la
pression de l’air arrive à contre-balancer le poids
total de l’appareil.
La cause de ces échecs doit principalement être
attribuée à la nature du terrain, c’est-à-dire à la
configuration qu’il présente à l’endroit où se trouve
l’appareil quand il est capable de s’envoler. Par
exemple, lorsque le terrain offre une dénivellation
latérale assez marquée, il en résulte une inclinaison
vers la gauche ou vers la droite des surfaces
sustentatrices, et alors la poussée de l’air vient
détruire l’équilibre. En d’autres termes, l’aéroplane
n’étant pas d’aplomb retombe brusquement sur le
sol.
On est donc en droit de poser ce principe qu’il faut
au moment de l’essor que les transversales de
l’aéroplane soient parfaitement horizontales.
Le pilote peut sans doute, par le jeu des ailerons ou
par le gauchissement, redresser suffisamment
l’appareil, mais il faut pour cela de sa part une très
grande expérience et une rapidité de décision et
d’action que ne possèdent pas encore les
débutants.
Malgré l’enseignement si éclairé du capitaine
Ferber, délégué par la Ligue Aérienne à la direction
de l’école des pilotes à l’aérodrome de Savigny-sur-
Orge*, il ne s’est pas encore formé de bons élèves
et l’appareil d’essai mal lancé s’est plusieurs fois
brisé, ce qui a entraîné des réparations ayant coûté
plus de 5.000 fr. pour une période de trois mois.
Certes, la méthode française, qui n’exige pas un
appareil de lancement, comme c’est le cas pour les
Wright, est de beaucoup préférable et ce sera
certainement celle de l’avenir, à moins qu’on ne
réussisse à réaliser un organe auxiliaire de
lancement adhérant au corps de l’aéroplane. Mais
on n’en est pas encore là et il faut reconnaître que
tandis que les aviateurs américains ont eu rarement
des manques dans le très grand nombre d’envolées
et de prouesses qu’ils ont effectuées, entraînant
très peu de dépenses pour les réparations, les
aviateurs français par contre ont eu à subir tant de
faux-départs, si souvent accompagnés d’accidents,
que l’ensemble des frais de réparations ou de
construction des nouveaux appareils a dépassé 2
millions de francs. Nous savons que les dépenses
du sympathique et persévérant M. Blériot entrent
dans cette somme pour près de 700.000 francs.
C’est poussé par ces considérations que, dès le
début de l’aviation, M. Armengaud Jeune a engagé
les aviateurs à aménager le sol, au moins dans la
partie de l’aérodrome où ils doivent effectuer leur
vol, de telle manière qu’ils puissent prendre leur
élan en se dirigeant contre le vent et en assurant à
leur appareil la position normale d’équilibre.
Le projet qu’il propose répond à cette condition. Il
consiste à établir une ou plusieurs plates-formes
étoilées sur l’aérodrome. Chacune d’elles consiste
en un terre-plein de faible hauteur, 50 cm au plus, à
laquelle donnent accès des rampes ayant une
largeur de 15 mètres et une longueur de 50 à 100
mètres. Le nombre des rampes pourra être de 8,
10, 12, ce qui fournira autant de voies de départ
parmi lesquelles l’aviateur choisira celle qui se
rapprochera le plus de la direction du vent au
moment de l’expérience.